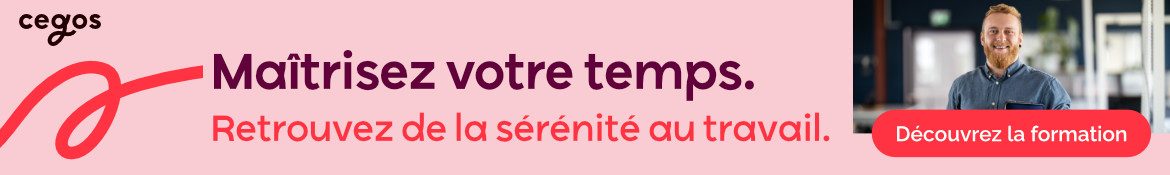Hugues
Lenoir
Hugues Lenoir vient d'achever une recherche exploratoire auprès d'acteurs de la VAE engagés dans des expérimentations en entreprise pour des travailleurs en situation d'illettrisme. Elle le conduit à inviter les formateurs à chercher “les moyens de travailler avec l'oral de manière à ce que celui-ci fasse preuve, au même titre que l'écrit", pour reconnaître les savoir-faire de ces personnes et assurer ainsi davantage d'équité.
Par Centre Inffo - Le 15 janvier 2004.
Quel bilan tirez-vous de cette recherche ?
Hugues Lenoir : J'ai travaillé autour d'une vingtaine d'expériences de validation des acquis de l'expérience dans des associations et entreprises qui sont soit en réflexion, soit engagées, ou ont abouti [ 1 ]Les entretiens ont été réalisés auprès d'entreprises de l'agroalimentaire, de l'industrie automobile, de la métallurgie, de la restauration collective, des secteurs sanitaire et social, des organismes de formation et des collectivités territoriales.. L'ensemble de mes interlocuteurs considère qu'il est possible de valider les acquis de l'expérience des adultes en situations[ 2 ]Hugues Lenoir a insisté sur le pluriel du mot afin de mettre en évidence la diversité des situations d'illettrisme. d'illettrisme. Ils reconnaissent cependant qu'il y a des débats sur les procédures et le type de diplômes auxquels ces personnes ont plus ou moins facilement accès. Tous reconnaissent les savoir-faire, compétences et professionnalisme de ces personnes à qui, pour des raisons historiques, il manque la maîtrise d'outils, les savoirs de base qui, jusqu'à présent, n'étaient pas requis. Ce sont les évolutions des métiers qui font que l'usage de l'écriture et de la lecture est de plus en plus incontournable. On ne s'aperçoit que fort tardivement que ces adultes sont en situations d'illettrisme : ce n'est pas qu'ils ne font pas correctement leurs tâches, mais parce que celles-ci ont changé.
La recherche que j'ai menée soulève la question de ce qui est acceptable au niveau de la formalisation : à savoir, d'une part, dans quelles conditions, pour certains diplômes, une formalisation orale pourrait remplacer une formalisation écrite, et, d'autre part, compte tenu de cette “oralisation" de la connaissance, comment conserver une trace matérielle de la preuve ? En effet, il est aujourd'hui très facile de conserver les traces sonores des savoirs manifestés par telle ou telle personne. La connaissance des adultes en situation d'illettrisme, oralisée à leur niveau, peut être conservée au même titre que celle des scientifiques, oralisée et conservée dans le cadre de l'encyclopédie de tous les savoirs. Il y a comme une injustice dans le fait que ceux qui maîtrisent moins l'écrit soient jaugés selon les mêmes critères que ceux qui le maîtrisent mieux.
Inffo Flash : Le recours systématique à l'écrit dans les procédures de validation réduit-il les chances des salariés en situations d'illettrisme d'accéder à un diplôme ?
Hugues Lenoir : La question de la validation et de l'écrit est sans doute cruciale pour les adultes en situations d'illettrisme. D'une part, le recours systématique à l'écrit pourrait être discriminatoire par rapport à des personnes qui ont des capacités et des qualités professionnelles reconnues par leur entreprise, mais qui ne peuvent pas obtenir des qualifications certifiées sous prétexte qu'elles ne maîtrisent pas suffisamment l'écriture, la lecture et éventuellement, le calcul. D'autre part, il pourrait renvoyer l'ensemble de ces publics, non pas vers des dispositifs de validation de type Éducation nationale ou ministère de la Santé et du secteur social, mais vers les CCP de l'Afpa. Ces organismes pourraient comprendre que si les adultes en situation d'illettrisme ne validaient leurs expériences qu'au travers du dispositif du ministère des Affaires sociales, il pourrait y avoir une dévaluation ou une “démonétarisation" des titres de l'Afpa, au moins pour ces publics-là.
Que valide-t-on ? Les savoirs d'action ou les savoirs d'expérience ? Si l'on valide les compétences, est-il alors nécessaire de recourir à l'écrit ? Auquel cas, la démonstration par l'action ne suffit-elle pas ? Si l'on valide les connaissances, cette validation se légitime-t-elle mieux par l'écriture ? N'y a-t-il pas d'autres façons de manifester la connaissance (par le film, la cassette audiovisuelle, l'objet créé...) ?
Il nous faudrait ré-interroger la place de l'écrit dans notre société. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faille que ces personnes soient privées d'accès à des formations leur permettant, à terme, d'acquérir l'écriture et la lecture. Il faut dissocier le fait qu'ils ont nécessairement besoin, à court ou à moyen terme, de ces outils-là (compte tenu de l'évolution de la société, des technologies et des situations de travail). Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas encore acquis cette maîtrise que l'on ne doit pas certifier tout ou partie de leurs compétences au regard de la loi sur la validation des acquis de l'expérience.
Mais la vraie question est de savoir s'il n'existe pas des moyens de travailler avec l'oral de manière à ce que celui-ci fasse preuve au même titre que l'écrit. On s'aperçoit que même la connaissance scientifique aujourd'hui se transporte et se communique très largement par l'oral, dans les colloques, dans les prises de paroles de type colloques scientifiques dans les universités. Dans ces lieux, la parole est reconnue comme un vrai vecteur de manifestation de la connaissance. Si cela est vrai pour certains, pourquoi pour d'autres, en particulier les adultes en situations d'illettrisme, la parole ne serait-elle pas aussi reconnue comme un vrai vecteur de la connaissance ? Et si l'on acceptait que l'oral (formalisé, à définir) vaut l'écrit, on pourrait alors dire que ce qui est formalisé à l'oral vaut ce qui l'est à l'écrit. Il faudrait donc repenser le modèle dominant de la culture par l'écrit.
C'est un chantier qui nécessite une profonde réflexion, recherche, voire confrontation avec les tenants de l'écrit, de la formalisation, des mises en situation, etc. La recherche que j'ai menée ne me donne vraiment pas de pistes dans ce sens. Tous mes interlocuteurs considèrent que la question de l'écriture est tout à fait essentielle. Ils proposent, pour remplacer l'écrit, les photos, les diaporamas, les petits logiciels d'informatique. Il faut reconnaître que même les personnes les mieux formées ont aussi du mal à formaliser les connaissances de l'action par l'écrit, et a fortiori par l'oral[ 3 ]Pierre Pastré le montre dans une étude sur les ingénieurs de l'énergie nucléaire de EDF et Gaz de France. (Voir Pierre Pastré, “Comprendre après coup grâce à la simulation" Éducation permanente, supplément EDF-GDF n° 139, 1990).. Ce qui prouve que le travail de formalisation est extrêmement délicat, quelle que soit la forme qu'on souhaite lui donner. Les pistes sont à trouver ensemble. Elles me semblent essentielles si on ne veut pas qu'une partie de la population soit, peu ou prou, exclue de la VAE ou ne puisse accéder qu'aux parties pratiques des CAP, comme pour les jeunes en délicatesse avec l'institution scolaire. Ces personnes n'auraient donc jamais accès à un CAP complet, puisque soumis à des exigences de formalisation écrite. La reconnaissance des acquis exclusivement pratiques par le secteur employeur ne sera pas évidente si elle ne constitue qu'une partie du CAP, ce qui ne représentera pas une vraie certification.
Inffo Flash : Comment, selon vous, les organismes pourraient-ils alors contourner le blocage de l'écrit dans les procédures de validation des acquis pour cette catégorie de salariés ?
Hugues Lenoir : Il faut que les accompagnateurs, les formateurs et les responsables formation, ainsi que l'encadrement intermédiaire nous fassent savoir que ces personnes ont des connaissances réelles qui peuvent être manifestées autrement que par l'écrit. Bien que ne maîtrisant pas les savoirs de base, la plupart de ces personnes ont des connaissances scripturales (faire une liste de courses pour tel ou tel acte de la vie domestique, etc.). Il serait donc utile de revaloriser cette “écriture domestique" pour élaborer des formalisations qui, en s'améliorant, pourraient aboutir à des formes plus satisfaisantes pour les institutions de certification. Il faut s'interroger sur le niveau réel des productions écrites des jeunes gens qui préparent et qui passent des CAP. Nous ne pouvons pas être plus exigeants en matière de capacité d'écriture et de formalisation écrite pour des adultes en situations d'illettrisme que nous ne le sommes quand il s'agit de certifier des jeunes gens en formation initiale. Il nous faut revoir notre système d'évaluation et nous demander si nous n'en exigeons pas davantage de ceux issus de la deuxième chance que de ceux issus de la formation initiale. Ce n'est pas parce que ces personnes obtiendraient éventuellement une certification à 100 % par la validation qu'il ne faut pas mettre en place des dispositifs, en amont, en aval ou durant la phase de validation, leur permettant de consolider, de se réapproprier et développer leurs capacités d'écriture et de lecture. La VAE ne doit pas devenir un prétexte pour ne plus former les publics en situations d'illettrisme. Elle doit plutôt être un prétexte pour déclencher la formation, reconnaître les individus pour ce qu'ils sont : compétents et en capacité d'apprendre.
Pour cela, le ministère de l'Éducation nationale ou celui du Travail pourrait mettre en place un groupe de recherche-action qui réfléchirait sur la question.
Inffo Flash : Dans l'hypothèse où il n'y aurait plus d'écrit dans la procédure de validation, existe-t-il encore beaucoup d'emplois sans utilisation d'écrit ?
Hugues Lenoir : C'est bien la question. Ce n'est pas parce que nous validerions des compétences ou des connaissances aujourd'hui, au regard d'emplois réels de 2004, qu'il ne faut pas préparer les emplois de 2010 ou 2012, qui requerront de plus en plus l'utilisation de la lecture sur les écrans d'ordinateur ou de l'écriture pour remplir des fiches liées à la qualité ou à des dysfonctionnements techniques. Il est clair, selon mes interlocuteurs dans la recherche, que les emplois qui, à terme, n'utiliseront plus du tout d'écriture ou de lecture, vont sans doute encore se raréfier. Les populations (surtout les jeunes), qui étaient déjà en difficulté face aux évolutions technologiques des années 1980-2000, pourraient être encore plus en difficulté face aux évolutions des années 2000-2010. Ceux qui sont déjà dans l'emploi, qui auraient des compétences, ont peut-être des capacités d'adaptation. Les jeunes qui n'auront pas eu la chance de développer ces compétences dans des situations de travail ou dans des situations spéciales auront beaucoup plus de difficultés à faire valider leur expérience professionnelle ou à repartir de leur expérience pour enclencher le dynamisme d'apprentissage. Raison de plus pour que la formation de ces publics soit renforcée. Certes, la lutte contre l'illettrisme est une priorité nationale, mais malheureusement, les budgets pour la formation des adultes sont notoirement insuffisants, compte tenu de la popu-lation concernée par le problème[ 4 ]Selon l'enquête IVQ (Inffo Flash n° 625), entre 10 % et 14 % de la population sont concernés, soit pour une entreprise de 1 000 personnes par exemple, 100 à 140 personnes à former..
Propos recueillis par Knock Billy
Notes
| 1. | ↑ | Les entretiens ont été réalisés auprès d'entreprises de l'agroalimentaire, de l'industrie automobile, de la métallurgie, de la restauration collective, des secteurs sanitaire et social, des organismes de formation et des collectivités territoriales. |
| 2. | ↑ | Hugues Lenoir a insisté sur le pluriel du mot afin de mettre en évidence la diversité des situations d'illettrisme. |
| 3. | ↑ | Pierre Pastré le montre dans une étude sur les ingénieurs de l'énergie nucléaire de EDF et Gaz de France. (Voir Pierre Pastré, “Comprendre après coup grâce à la simulation" Éducation permanente, supplément EDF-GDF n° 139, 1990). |
| 4. | ↑ | Selon l'enquête IVQ (Inffo Flash n° 625), entre 10 % et 14 % de la population sont concernés, soit pour une entreprise de 1 000 personnes par exemple, 100 à 140 personnes à former. |