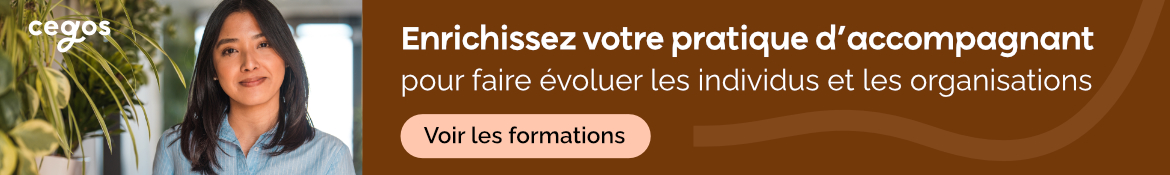Christian Ville, en quête de compromis positifs
“D'abord quelqu'un qui a un parcours."
Par Nicolas Deguerry - Le 01 octobre 2012.
“Au secours, les énarques reviennent !"
Le Figaro Magazine [ 1 ]21 septembre 2012. vous aura prévenu.
Mais restons calmes et cherchons des raisons d'espérer. Ouf ! L'homme dont il est question aujourd'hui, pas plus que Thierry Repentin, le ministre dont il dirige le cabinet, n'a “fait l'Éna". Anecdotique ? Voire…
C'est Gérard Larcher lui-même qui nous
l'a rappelé : “Christian Ville, c'est d'abord quelqu'un qui a un parcours."
Et, de fait, jeune inspecteur du Travail à Saint-Étienne au début des années 1980, il n'a pas attendu longtemps avant de se retrouver aux premières loges d'une crise qui voit s'écrouler des pans entiers de l'économie locale. Dès lors, il se passionne pour le métier
que l'étudiant avait trouvé si “exaltant" : navigant entre “une forme de contrôle du droit des salariés et une capacité à faire en sorte qu'il y ait du dialogue social", il dit à maintes reprises toute la “curiosité"
qu'il manifeste pour tenter de “comprendre les phénomènes sociaux et les faire évoluer : ce qui me motive dans mes choix de carrière, c'est ce que je vais apprendre, pas forcément sur la matière, mais aussi sur les acteurs, la façon dont ils se positionnent, dont ils agissent, etc.". Dans quel but ? “Arriver à faire converger les gens dans des actions communes, c'est cela qui est intéressant."
Derrière cette motivation se trouve très
certainement le fil directeur de sa carrière. Exemple en 1985, à l'Institut national du travail, où il crée aux côtés du directeur Jean Courdouan les “sessions extérieures", des modules mensuels qui réunissent cadres d'entreprise, syndicalistes et fonctionnaires. Pour les heureux élus, s'ensuivent “des conférences animées par des grands noms du social et, surtout, des voyages à l'étranger qui permettaient d'ouvrir l'horizon". Objectif ? “Essayer d'avoir des références communes, non pas pour essayer de construire des consensus, mais pour bien débattre." La confrontation des idées comme moteur social, Christian Ville assume : “Je n'ai pas une volonté ecclésiastique, pas plus que je ne recherche partout l'œcuménisme, mais je crois que les sociétés se construisent sur la base de compromis positifs : il y a des acteurs porteurs d'enjeux différents et les sociétés avancent parce que, à des moments donnés, les gens
se rencontrent et créent des compromis."
La méthode de la “grande conférence sociale" n'est pas loin…
Les acteurs de la formation professionnelle apprécient-ils ? Pour l'action du directeur de cabinet, il faudra patienter, mais pour
la courte présidence du CNFPTLV qu'il a exercée de février à juin 2012, Françoise Amat ne laisse planer aucun doute : “C'est un homme de dialogue, avec la volonté de faire avancer les choses, sans idées a priori", estime-t-elle.
“Une phrase me semble très bonne dans la note qu'il a fait adopter le 20 juin : « Ces orientations n'ont de sens d'atteindre leurs objectifs qu'autant qu'elles seront concrètes et opérationnelles »".
Commentaire de l'intéressé : “Si on essaie de construire des orientations, il faut aller plus loin que les déclarations d'intention et se donner des objectifs d'actions suffisamment lisibles et explicites pour être repris sur le terrain." Et de souligner : “Il faut profiter de cette instance qui réunit les trois partenaires essentiels de la formation professionnelle pour tenter de répondre aux enjeux qui se posent, c'est-à-dire le cloisonnement des politiques."
Là encore, le parcours de Christian Ville éclaire l'importance accordée à l'amélioration des convergences : chargé de mission auprès du préfet de la région Rhône-Alpes, il se souvient d'avoir bâti aux côtés de nombreux partenaires un plan de lutte régional contre l'exclusion, “qu'une administration toute seule n'aurait pas pu porter", assure-t-il.
Devenu DRTEFP du Limousin, il relève, lors de la médiation
d'un conflit concernant les éboueurs de Limoges, que “ce ne sont pas nécessairement ceux qui ont fait les plus grandes études qui ont les meilleures appréhensions des opportunités politiques et des stratégies de négociation"… Quant au souci du terrain, il l'approfondit en devenant directeur général adjoint des services de l'exécutif rhônalpin, et en ressort convaincu que le cadre de la décentralisation rend indispensable le rapprochement des fonctionnaires d'État et des élus.
Promu en 2010 inspecteur général des affaires sociales, c'est dans ce cadre qu'il devient l'un des coordonnateurs du rapport Larcher sur la formation professionnelle.
“Entre un gaulliste social et un social-démocrate, les divergences ne sont pas si grandes", estime l'ancien président du Sénat : “Il a commencé comme inspecteur du travail, j'ai été ministre du Travail, nous nous comprenions très bien, je suis certain de sa profonde honnêteté intellectuelle", juge-t-il. Et d'ajouter, en clin d'œil à son
rapport, “Christian Ville aux côtés d'un ministre, c'est un élément stable et pragmatique dont la première préoccupation sera celle de la formation professionnelle, de l'emploi et de la compétitivité".
Vraiment ?“Je ne peux pas dire que le rapport Larcher sera la feuille de route du ministre, mais beaucoup de propositions ont été débattues lors de la table ronde formation professionnelle de la grande conférence sociale", répond le directeur de cabinet.
Balayant tout intérêt pour le pouvoir à sa prise de fonction, Christian Ville en revient à sa quête du compromis : sur ces questions, coexistent “une vision de l'État, qui représente l'intérêt général, une vision des partenaires sociaux, qui sont légitimes à représenter les intérêts des salariés et des entreprises, et une vision des collectivités territoriales, qui ont pris des responsabilités : c'est en faisant fonctionner ce jeu à trois que les choses peuvent avancer…".
Notes
| 1. | ↑ | 21 septembre 2012. |